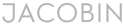L’ouvrier agricole pendjabi Satnam Singh a été gravement blessé dans un accident dans une ferme italienne, et son patron l’a laissé mourir. Cette affaire choquante montre le peu de considération que montre le secteur agricole en Italie pour la vie des travailleurs et travailleuses immigré·e·s.
Le 19 juin dernier était un jour de deuil, l’agromafia italienne a fait une nouvelle victime. Satnam Singh, immigré de 31 ans, est mort dans un hôpital de Rome, deux jours après qu’un tragique accident entraîne l’amputation de son bras et des fractures des deux jambes. Il était aux commandes d’une machine agricole dans une ferme près de Latina, une province rurale située à 80 km au sud de Rome, où des réseaux de criminels tirent systématiquement parti du travail de milliers d’immigré·e·s venus du Pendjab, en Inde. Sa femme, Sony, et lui y travaillaient sans contrat depuis 2021, plantant des pastèques pour la modique somme de 4 € par heure. Les actes de leur patron après l’accident ont contribué à ce que Satnam ne reçoive pas de soins médicaux suite à ses blessures.
Au moment de l’accident, Satnam travaillait déjà depuis 12 heures. Lorsque la machine lui a mutilé le corps, le padrone (littéralement : « propriétaire », comme les employeurs dans la région aiment être appelés, un terme qui rappelle la dépendance féodale) italien a confisqué les téléphones de tout le monde dans la ferme et les a empêché d’appeler une ambulance. À la place, le patron a transporté Satnam, déjà inconscient, et sa femme qui pleurait désespérément, sur des kilomètres dans sa camionnette. Il les a abandonnés derrière leur maison avec les morceaux du bras coupé de Satnam dans une boîte à fruit, avant de prendre la fuite – plutôt que de les emmener immédiatement à l’hôpital, ce qui aurait pu sauver la vie de Satnam. S’il les avait emmenés aux urgences, il aurait fait face à des conséquences juridiques pour avoir employé des travailleurs sans contrat et sans protections.
Le caractère inhumain de ses actes a suscité une indignation générale. Cet évènement a remis sur la table le débat sur le problème des caporalato (services des pourvoyeurs de main-d’œuvre), une pratique qui affecte presque tous les immigré·e·s qui travaillent dans le secteur agricole italien. Cette pratique est documentée depuis de nombreuses années par les chercheurs et activistes, dans la province de Latina et au-delà. La semaine dernière, le débat actuel qui porte sur « la lutte contre le fléau qu’est le caporalato », prôné par les politiciens des gouvernements présents et passés, et réitéré, lors des grèves organisées en soutien à Satnam Singh et à tous les travailleurs et travailleuses exploité·e·s par la Confédération générale italienne du travail, la Confédération italienne des syndicats de travailleurs, et l’Union italienne du travail. Le maire de Latina (membre du parti politique Fratelli d’Italia de Georgia Meloni, invitée à prendre parole lors des deux manifestations) a insisté sur le fait que « le caporalato est une forme d’esclavagisme qui n’est pas propre à notre culture, notre ville ou notre nation : il doit donc être éradiqué ». Elle a repris comme excuse un stéréotype familier qui décrit les Italiens comme étant des brava gente, de « braves gens ».
Il est toutefois problématique de mettre exclusivement en avant le caporalato. Cela suggère à tort que le problème de l’exploitation des travailleurs et travailleuses concerne uniquement les immigré·e·s sans-papiers et représente principalement l’œuvre de quelques vils patrons et de leurs cupides et impitoyables intermédiaires, ou « caporali », souvent eux-mêmes de la même origine ethnique que ces immigré·e·s. Une histoire plus complexe se cache derrière le problème des caporalati sur le marché italien du travail. C’est un problème qui concerne l’ensemble du cadre juridique, politique et culturel, qui fait presque des caporali des incontournables à la fois pour les employeurs et pour les immigré·e·s.
Maintenir la vulnérabilité, la division et l’exploitation au sein de la communauté des travailleurs et travailleuses immigré·e·s
En Italie, une politique d’immigration de plus en plus sélective, alimentée par une propagande politique sur « le grand remplacement » et la peur des étrangers et étrangères, demande l’impossible aux migrant·e·s provenant de pays non membres de l’Union européenne (UE) qui souhaitent travailler et s’installer dans le pays. Ce genre de demande n’arrête pas l’immigration, mais maintient ceux et celles qui arrivent et restent en Italie dans une situation de vulnérabilité et d’exploitation, conférant un pouvoir disproportionné aux employeurs et aux intermédiaires. Ces derniers ont appris à tourner la législation italienne à leur avantage en développant une affaire qui prospère grâce à l’exploitation et l’escroquerie directe de milliers d’hommes et de femmes du Pendjab et d’ailleurs.
Pour commencer, l’État d’Italie exige que les potentiels migrant·e·s travailleurs et travailleuses reçoivent l’invitation d’un employeur. À leur arrivée, cela conditionne l’acquisition d’un permis de séjour (et donc leur statut légal) à la signature d’un contrat de travail formel avec un employeur parrain. Les demandeurs et demandeuses payent un montant initial allant de 10 000 € à 20 000 € aux caporali qui arrangent les accords et partagent cet argent avec le patronat local.
Les immigré·e·s ont tendance à voir les caporali comme des facilitateurs et des assistants et non des trafiquants. Cela est confirmé par le mot neutre « agent » qu’ils et elles utilisent pour parler des caporali. Ces « agents » sont considérés comme des fournisseurs de services dont les prix, comme ceux de tout autre service, sont régis par l’offre et la demande. Par conséquent, il varie aussi au fil du temps : il y a 15 ans, si 5 000 € auraient suffi à atteindre le sud de l’Europe (rendant l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Grèce également accessibles aux plus pauvres et aux moins éduqué·e·s des personnes venant du Pendjab, employé·e·s comme travailleurs et travailleuses non qualifié·e·s, contrairement aux États-Unis et au Royaume-Uni), aujourd’hui le montant a triplé, tout au moins. En raison des conditions socioéconomiques qui ne cessent de s’aggraver au Pendjab, les habitants de cette région désirent de plus en plus émigrer, malgré le coût élevé, et même si y parvenir implique de contracter des dettes ou vendre ses biens. Cette dette, à son tour, est un lourd fardeau aussi bien pour les migrant·e·s que pour leurs familles restées au pays, ce qui remet en cause le rôle célébré des transferts transnationaux de fonds permettant le développement des communautés d’origine des migrant·e·s.
Une fois arrivés en Italie, les migrant·e·s du Pendjab ne reçoivent pas souvent les contrats de travail promis par leurs employeurs, ou alors ils et elles sont tenus de débourser encore plus d’argent (souvent entre 5 000 et 15 000 €) afin de transformer leurs visas en véritables permis de travail. Si les migrants n’ont toujours pas obtenu un contrat régulier après l’expiration du visa de travail, valable 9 mois, leur statut devient automatiquement « irrégulier » (ce qui selon la Loi Bossi-Fini de 2002 représente un délit pénal passible d’une peine et peut entraîner leur expulsion du pays). Ils et elles se retrouvent bloqué·e·s dans les limbes de la dépendance et la subordination absolue à ceux et celles qui les exploitent. Sous le poids des dettes contractées auprès d’usuriers et de banques pour payer les agents et les caporali et faute de moyens légaux pour présenter individuellement une demande de permis depuis l’intérieur du pays, ils et elles sont dans l’obligation d’accepter n’importe quelles conditions pour rester en Italie et rembourser leurs dettes. Leur vulnérabilité – aggravée par les barrières linguistiques, leur isolation à la campagne, l’absence de soutien de l’État en faveur de leur intégration, l’ignorance de leurs droits, ainsi qu’une bureaucratie opaque, compliquée et d’une lenteur incompréhensible – les empêche de dénoncer leurs exploitants par peur de violentes représailles, de perdre leur unique gagne-pain, de s’exposer à des conséquences juridiques, ou d’être expulsé·e·s.
C’est ainsi que les padroni et caporali peuvent exploiter et maltraiter les migrants et migrantes grâce à la loi elle-même. Ils sont indirectement soutenus par des campagnes politiques et culturelles fondées sur la criminalisation et la sécurisation de l’immigration plutôt que la protection des droits humains et du travail des migrants et migrantes. Traiter le patron de Satnam de monstre (et il pourrait bien en être un) est une solution de facilité : accuser les « mauvaises graines » individuelles détourne toujours l’attention des forces structurelles qui sont à l’origine de l’opportunité qu’ils ont d’exercer leur pouvoir.
La mort de Satnam n’est pas un accident provoqué par un travailleur « distrait » aux commandes d’une machine ou même par la cruauté de son employeur. Elle est le résultat d’un système juridique, politique et culturel qui viole les droits humains fondamentaux, obligeant les migrants et migrantes à travailler dans des conditions d’exploitation extrêmes, les réduisant à l’état de ressource à exploiter dont on se débarrasse lorsqu’elle est épuisée. Aujourd’hui en Italie, des dynamiques systémiques enfoncent, mutilent et brisent les travailleurs et travailleuses immigré·e·s, les laissent mourir, comme la machine et son propriétaire l’ont fait pour le corps de Satnam.
Dans mon travail de doctorante qui étudie la communauté pendjabi dans la province de Latina, au cours des trois années qui ont précédé cet incident, j’ai interrogé des centaines d’hommes et femmes tout autant sous le coup du surmenage, de la sous-rémunération, de l’exploitation, de la discrimination et sans-papiers que Satman et Sony. J’ai écouté leur récit de ces abus. Ils se plaignent tout en étant assez résigné·e·s pour qualifier cette situation de « normale ».
Pour cette raison, ce n’est pas uniquement la tristesse profonde de la mort de Satnam qui me pousse à écrire, mais également la rage, la honte et le besoin d’élever la voix contre les innombrables injustices que j’ai observées. C’est pour Jagdish, 36 ans, qui s’est cassé un doigt au travail et à qui l’employeur a demandé de mentir à l’hôpital que l’accident s’est passé à la maison, s’il voulait garder son emploi une fois guéri. Pour Balvir, 48 ans, qui a été écrasé sous un chargement de pommes de terre au travail puis abandonné chez lui à minuit par le propriétaire, après quoi sa femme et sa fille de 10 ans l’ont conduit à l’hôpital à travers les champs sombres de Pontine. Pour Pardeep, 28 ans, qui, ayant laissé sa femme et ses enfants en Inde, a dépensé 16 000 € pour venir en Italie et ne souhaite plus qu’une seule chose : retourner en Inde le plus tôt possible, puisque « les gens ici ne cherchent qu’à vous exploiter et prendre votre argent ». Il récolte des pastèques pour 2 € de l’heure pendant 10 heures chaque jour. Son visa va bientôt expirer et son employeur lui demande une somme de 5 000 € pour lui fournir un contrat de travail afin de régulariser sa situation. Pour Daljeet, 45 ans, qui s’est cassé le dos dans une plantation de champignons il y a dix ans et, après avoir osé se plaindre, attend toujours d’être indemnisée. Pour mon ami Sanjeep, 25 ans, qui ramasse des courgettes 13 heures par jour et qui est le seul dans l’équipe à travailler sans contrat. Il est le plus travailleur, le plus gentil. Hier son employeur a « plaisanté » en disant que s’il se blesse comme Satnam, il demandera à ses collègues de le balancer dans le canal à proximité. Mais ça n’a rien de drôle.
Surmenage, exploitation, sans-papiers
Au cours du dernier siècle, après la partition postindépendance de l’Inde et la libéralisation de son économie, le Pendjab a sans cesse été en proie à des crises économiques, politiques, environnementales et sociales qui ont poussé un nombre croissant de pendjabis à émigrer. Une étude récente menée par la Punjabi Agricultural University révèle que 74 % de l’émigration du Pendjab entre 1990 et 2022 a eu lieu au cours des six ultimes années de cette période. Aujourd’hui, le Pendjab est le deuxième État indien selon le taux d’émigration. La province de Latina au sud de Rome, une plaque tournante de la production agricole dans le centre-sud de l’Italie, est devenue la destination la plus prisée des migrants pendjabi (selon Istat, une agence de statistiques publiques, 7 parmi les 10 municipalités d’Italie au plus grand nombre de résidents indiens inscrits se trouvent dans la province de Latina).
Ces personnes sont particulièrement attirées par la grande demande de main-d’œuvre agricole et la présence d’une communauté pendjabi qui s’y est établie depuis les années 80. Afin de maximiser les profits et de maintenir des coûts de production assez bas pour rester compétitif sur le marché de l’UE, le florissant secteur agroalimentaire dans la province (comme l’a signalé initialement le sociologue Marco Omizzolo, l’un des premiers et plus féroces critiques) repose sur un réseau international de trafic d’êtres humains pour fournir un effectif renouvelable à l’infini de travailleurs et travailleuses migrant·e·s saisonniers à exploiter dans les champs. Ce réseau comprend employeurs et professionnels italiens, des caporali et intermédiaires à la fois de nationalités italienne et étrangères, ainsi que, parfois, des fonctionnaires corrompu·e·s des institutions publiques.
Beaucoup d’ouvriers et d’ouvrières pendjabi effectuent des travaux manuels intensifs, cueillent et emballent des fruits et légumes pendant 12 à 14 heures par jour ou plus, 6 ou 7 jours par semaine, sans aucune protection ou assurance. En contrepartie ils et elles reçoivent des sommes dérisoires, bien en dessous de ce qui peut leur permettre de vivre. Leur recrutement a lieu dans des groupes Whatsapp par un message envoyé la veille au soir, leur indiquant l’heure et le lieu de rencontre vers lequel se rendre en parcourant, à bicyclette, de longues et dangereuses distances sur l’autoroute. Ceux qui n’ont pas de permis de séjour, comme Satnam et Sony, travaillent sans contrat. Si un contrat est délivré, il ne l’est souvent que pour quelques mois, et ne préserve donc pas toujours des caprices des employeurs. Ils et elles se retrouvent ainsi dans des conditions de précarité structurelle : les employeurs peuvent non seulement leur donner des salaires plus bas et les maintenir en position de subordination en les menaçant de ne pas leur donner un nouveau contrat, ce qui met en péril leur résidence légale, mais la délivrance exclusive de contrats saisonniers et à court terme dispense l’employeur de garantir l’accès aux prestations sociales telles que les congés payés ou de maladie des travailleurs et travailleuses, que personne ne reçoit jamais. En effet, beaucoup ignorent même leur droit à une rémunération en temps de maladie ou de congés : lorsque leurs contrats arrivent à terme et à la fin de la saison des récoltes. On les informe simplement, « à partir de demain vous êtes libres » : une « liberté » synonyme d’absence de travail et de paie.
Le nombre d’heures de travail d’un bulletin de salaire est toujours considérablement réduit par rapport à celui des heures réellement effectuées. Les employeurs peuvent ainsi payer moins d’impôts tandis que les employés et employés perçoivent moins de cotisations d’assurance pension ou d’allocations de chômage. Le paiement est souvent à la pièce, bien que le contrat stipule qu’il doit être mensuel, conformément au salaire négocié dans le CCNL – le Contrat collectif national de travail. Cette exigence d’une productivité supérieure pour un meilleur paiement pousse souvent les travailleurs et travailleuses à s’auto-exploiter, allant jusqu’à consommer des drogues telles que les opiacés et la métamphétamine (en connivence avec des médecins et pharmacien·ne·s corrompu·e·s), pour soulager la douleur d’un travail intensif et pousser leurs corps au-delà des limites de la fatigue.
Voilà comment se forme une réserve toujours grandissante de main-d’œuvre migrante dispensable et exploitable. Tels des soldats obligés de respecter tout ordre, peu importe le degré de risque pour soi et pour les autres. Sa disponibilité constante anéantit les efforts des autres qui travaillent et des syndicats pour négocier des salaires plus élevés et de meilleures conditions de travail, les empêchant de s’unir dans la lutte pour leurs droits. Le pouvoir de division de ce système capitaliste d’extraction est tel que la solidarité est impossible, même parmi les travailleurs et travailleuses originaires du même village. Tout le monde a peur de son prochain et de sa prétendue « jalousie » : l’autre est comme en concurrence, ennemi·e, obstacle à la propre survie. Quel dépit d’entendre que les collègues de Satnam ont hésité à témoigner par peur de perdre leur propre emploi. Leur désespoir est-il si puissant, au point de toujours vouloir garder cet emploi malgré la certitude qu’en cas de blessure, on les laissera pour morts dans leur propre sang, pour ensuite porter la faute de leur propre mort ?
Le suicide des ouvriers et ouvrières agricoles pendjabi aux dettes et au désespoir accablants, par exemple dans le cas tristement célèbre de Joban Singh, âgé de 25 ans, qui s’est ôté la vie en 2020, désigne les conséquences dévastatrices de ce système criminel d’exploitation et de trafic. Ce suicide comme la mort d’aujourd’hui nous concernent tous. Nous sommes responsables quand nous consommons sans nous poser de questions, les aliments bon marché produits par l’exploitation et la maltraitance systémique d’hommes et de femmes qui restent invisibles et souffrent de cette oppression. Nous sommes responsables dans une Italie qui a systématiquement failli à son devoir de protection envers ses travailleurs et travailleuses les plus vulnérables vis-à-vis des multiples forces qui les étouffent, les divisent et finissent par les tuer. La Constitution de l’Italie proclame « une République démocratique, fondée sur le travail ». Mais l’état ne tient pas compte de ces mêmes travailleurs et travailleuses dont le soin et le travail reproduisent la vie elle-même.
Annamaria Laudini est anthropologue et doctorante chercheuse à l’Institut universitaire européen de Florence, en Italie.