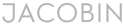Alors que la première semaine du Ramadan, le mois sacré de l’islam, touche à sa fin, l’avenir est incertain pour les réfugié·es palestinien·ne·s aux Philippines. Celles·eux qui ont fui la guerre à Gaza se retrouvent éparpillé·e·s dans la Manille métropolitaine, ballotté·e·s d’un groupe à l’autre, et désespéré·e·s de retrouver un sentiment de paix et de normalité.
Bien qu’un cessez-le-feu ait été conclu au début de l’année 2025, il y a cependant peu d’espoir pour les Gazaoui·es évacué·es aux Philippines.
À Quezon City, un peu moins d’une douzaine de familles palestiniennes vivent dans l’une des principales subdivisions de la ville, entassées dans un camp appartenant à un Philippin sensible à la détresse de leur situation.
« Nous sommes environ dix ou onze familles à vivre ici. Il y en a plus à Cavite », a indiqué le Docteur Hamza (nom réel non divulgué à sa demande), un professeur d’université de Gaza. « Notre contrat de location expire en mars. Après ça, nous ne savons pas où aller. »
Lorsque la guerre a commencé, Hamza et sa famille faisaient partie des dizaines de familles évacuées de Gaza par le ministère des Affaires étrangères (DFA), qui ne voulait initialement évacuer que leurs épouses qui étaient des citoyennes philippines. « Ils ne voulaient rapatrier que les femmes », a souligné Hamza avec ironie, « mais elles (nos épouses) ont dit qu’elles ne mettraient pas un pied dans l’avion si nous ne pouvions pas embarquer avec elles. »
À ce moment-là, l’est de Gaza était déjà la cible de bombardements à grande échelle ciblant des maisons, des écoles et des hôpitaux.
Hamza, habitant de l’est de Gaza, se souvient avoir vu la nouvelle se répandre le 7 octobre, premier jour du siège.
« Je me souviens des bombes qui tombaient. L’une d’entre elles a frappé des bâtiments à proximité du nôtre. Quand les obus ont commencé à se rapprocher de notre maison, j’ai finalement appelé un ami dans la partie ouest de la ville pour demander s’il avait un endroit disponible pour nous abriter. Nous sommes parti·es très rapidement cet après-midi-là, mais d’autres n’ont pas eu cette chance », a-t-il rappelé.
Peu de temps après, Gaza était rasée dans sa totalité. Alors qu’il faisait simplement ses courses, le fils de Hamza, Hassan, a été touché par une bombe qui a atterri près du magasin. « J’étais dans tous mes états. J’ai essayé de l’appeler sur son portable, mais il ne me répondait pas. Je ne savais pas quoi faire. » Quelques heures plus tard, Hassan est rentré chez lui, légèrement blessé.
Se rendant compte qu’aucun endroit n’était sûr, Hamza et sa famille ont décidé de partir vers l’ouest, près de la côte. C’est là qu’Hamza a retrouvé son ami Abdullah, un ingénieur également marié à une Philippine.
Partir de Gaza
Celles et ceux qui sont habitué·e·s aux bombardements réguliers d’Israël sur les villes palestiniennes ont pensé que cette guerre-là serait comme les précédentes. Mais le conflit qui a éclaté en octobre était bien différent cette fois-ci : plus brutal et sans distinction aucune.
« Avant, quand [les forces israéliennes] nous bombardaient, elles nous prévenaient pour permettre à la population d’évacuer. Maintenant, il n’y a pas d’avertissement », a déclaré Hamza. Lorsque le conflit a éclaté en octobre 2023, les habitants de Gaza étaient loin de se douter qu’il se transformerait en l’une des pires crises humanitaires à frapper la Palestine, une terre déjà criblée d’un siècle de génocide et de domination coloniale.
« Une bombe a frappé directement notre bâtiment », a déclaré Abdullah, l’ami de Hamza qui vit dans l’ouest de Gaza. « Ma famille se trouvait à l’intérieur au moment de l’impact. » La bombe a coûté la vie à 25 membres de la famille d’Abdullah. Comme Hamza, il a alors décidé qu’il était temps de partir.
Hamza et Abdullah sont très attachés aux Philippines puisqu’ils y ont déjà vécu. Abdullah a obtenu son diplôme d’ingénieur à l’université Emilio Aguinaldo et Hamza, le sien à l’université Santo Tomas. Dans un court moment de légèreté, tous deux ont ri en évoquant leur séjour à Manille.
Quand le DFA a finalement accepté de laisser les Palestinien·ne·s embarquer pour les Philippines, Hamza, Abdullah et leurs familles ont dû entreprendre un long et difficile voyage vers un camp de détention d’Égypte situé de l’autre côté de la frontière, où elle·il·s ont dû attendre d’être pris·e·s en charge.
Ce n’est qu’une fois dans ce camp qu’elle·il·s ont vraiment réalisé ce qu’elle·il·s laissaient derrière. Leurs travails, leurs familles, leurs entreprises : leur vie entière.
La vie à Manille
À leur arrivée aux Philippines, les familles ont été installées dans un hôtel à Pasay, en attendant qu’un logement soit disponible. Grâce à de nombreuses associations et organisations, les Palestinien·ne·s ont pu en trouver un à Marikina. Mais à cause de rumeurs selon lesquelles des communistes les auraient aidé·e·s, elle·il·s ont dû quitter ce logement un mois plus tard.
« On nous a dit que c’était dangereux de rester à Marikina, que la police nous surveillait et que les gens qui nous aidaient étaient d’extrême gauche ou des sympathisants rebelles », a déclaré Hamza. Elle·il·s ont fini par se retrouver à Quezon City, où des étudiant·e·s de l’université des Philippines, ainsi que diverses associations caritatives et des citoyen·ne·s ont organisé des collectes de fonds destinés aux familles palestiniennes.
À Manille, sans logement et dépossédé·e·s, celles et ceux qui ont fui les ravages du conflit à Gaza se retrouvent désormais au milieu d’une guerre : différente, mais tout aussi insidieuse. Elle·il·s se sont empêtré·e·s dans la politique locale, tiraillé·e·s entre divers groupes politiques et idéologiques. Les réfugié·e·s palestinien·ne·s ont en effet rapporté que les services de renseignement de la police les surveillaient de près et qu’ils savaient à quiconque elle·il·s parlaient. Par peur de perdre le peu de compassion que le gouvernement a à leur égard ou d’être utilisé·e·s comme des pions dans l’échiquier politique, il leur est maintenant difficile de faire confiance à n’importe qui prêt à leur venir en aide.
« Nous ne voulons plus être impliqué·e·s dans un quelconque conflit, nous voulons seulement la paix », dit-il, d’un ton à la fois exaspéré et teinté de peur.
Fatima et Mariam, deux Philippines mariées à des Palestiniens, ont parlé de la vie qu’elles ont laissée derrière elles à Gaza. « À Gaza, nous n’avons jamais vraiment eu le sentiment d’être étrangères : les gens nous ont bien accueillies dès le début. » Fatima et Mariam, ainsi que des dizaines d’autres Philippines, ont joué un rôle clé pour convaincre le DFA d’autoriser les Palestinien·ne·s à embarquer pour les Philippines. « Contrairement à la façon dont les médias la dépeignent, Gaza était un endroit tranquille. Il n’y a aucune violence sectaire. Nous ne regardons pas les gens en fonction de leur religion. Les chrétien·ne·s et les musulman·e·s vivaient côte à côte. Nous étions tous et toutes frères et sœurs. »
« Certaines des plus anciennes églises du christianisme se trouvent d’ailleurs à Gaza. Mais les bombardements israéliens les ont toutes détruites », a ajouté Hamza.
Un avenir incertain
Fin janvier 2025, un accord de cessez-le-feu a été conclu entre le Hamas et les forces israéliennes et a permis aux Palestinien·ne·s déplacés de retourner enfin chez elles·eux après un siège qui a duré 15 mois. Pour les Gazaoui·e·s exilé·e·s aux Philippines, cet accord a également fait naître l’infime espoir de rentrer auprès des familles laissées derrière.
« Évidemment que nous voulons rentrer chez nous et reconstruire Gaza, mais maintenant que Trump est au pouvoir, il veut faire de Gaza une station balnéaire », a indiqué Hamza. Lors de sa victoire aux élections présidentielles de 2024 aux États-Unis, Donald Trump a été clair sur sa volonté de renforcer le partenariat entre son pays et Israël. Trump est même allé jusqu’à exprimer son souhait d’acheter des terres à Gaza pour en faire des stations balnéaires.
À la suite des élections américaines et du soutien disproportionné au capital politique israélien par un gouvernement d’extrême droite à Washington, les Palestinien·ne·s ont également exprimé leur inquiétude quant à leur statut juridique aux Philippines, proches alliées des États-Unis et d’Israël. En l’état actuel des choses, elle·il·s n’ont pas de statut officiel de demandeurs et demandeuses d’asile, et ce, bien qu’elle·il·s aient plaidé leur cause auprès des représentant·e·s du gouvernement et du ministère de la Justice. « Nous n’avons obtenu aucune réponse pour le moment. Nous avons même demandé de l’aide auprès des sénateurs et sénatrices, mais toujours pas de réponse non plus. »
À l’intérieur du complexe où vivaient Hamza, Abdullah, Fatima et Mariam, les familles tentent tant bien que mal de retrouver un semblant de normalité. Les moindres détails du quotidien rythment la vie dans les appartements. Les enfants vont et viennent, vêtus de leur uniforme scolaire, leurs parents les amènent à l’école ou leur donnent des tâches à effectuer. Sur ses trois roues, un tricycle klaxonne devant le complexe, transportant des provisions pour un stand de nourriture du Moyen-Orient tenu par l’un·e des Palestinien·ne·s.
En mars, le bail de leur appartement expire. Maintenant qu’il ne reste plus rien des fonds provenant des dons et associations caritatives, les Palestinien·ne·s doivent faire face à l’incertitude. Alors qu’en Palestine, leurs compatriotes entament le processus de reconstruction, aux Philippines, l’avenir est incertain.
À 9 000 kilomètres de là, par-delà l’océan, les habitants de Gaza rompent le jeûne chaque soir, entourés de décombres et de poussière. De même, les Gazaouis de Manille rompent aussi leur jeûne, avec des mets palestiniens et des encas philippins. De part et d’autre, on tente de surmonter un traumatisme qui s’étend sur plusieurs générations. De part et d’autre, on tente de nourrir l’espoir d’un avenir meilleur.
Tous les noms ont été modifiés pour protéger les identités des personnes mentionnées dans l’article. Certains détails ont également été modifiés pour mieux cacher leurs identités. Toutes les histoires sont rapportées telles que les Palestinien·ne·s nous les ont racontées.
Photo: Jonah Kayguan/Bulatlat