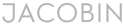La population d’Atlanta est dans l’attente d’une décision de justice pour savoir si elle sera autorisée ou non à voter au sujet de la construction d’un nouveau centre de formation de la police, baptisé « Cop City » par ses opposant·es, « Cop City » (la ville des flics). L’[Atlanta Public Safety Training Center [centre de formation à la sécurité publique d’Atlanta, nom officiel], d’un coût de 110 millions de dollars, attirerait des stagiaires de la police de tout le pays et hébergerait une ville fictive entière. Un modèle étonnamment similaire au « mini-Gaza » de l’armée israélienne, utilisé pour former les troupes israéliennes au combat urbain.
Le projet « Cop City » d’Atlanta fut proposé à la suite du soulèvement George Floyd en 2020. Ce mouvement de protestation de masse avait été déclenché par le meurtre de George Floyd par l’officier Derek Chauvin à Minneapolis (Minnesota) et par d’autres cas de violences policières racistes. Tout comme les précédentes vagues de protestations du mouvement Black Lives Matter, celle de 2020 a conduit à plusieurs réformes des forces de l’ordre, souvent imposées par les électeurs et électrices, par le biais d’initiatives de consultation publique et de référendum. Les institutions policières ont souvent réagi au mouvement en se préparant à la guerre. En effet, le conseil municipal d’Atlanta vota en faveur de « Cop City » juste un peu plus d’un an après que George Floyd eu émis son dernier souffle.
Dès l’annonce du projet, de nombreux·ses habitant·es d’Atlanta ont lutté avec acharnement afin d’empêcher la construction de « Cop City », alors que la municipalité fait tout ce qu’elle peut pour la construire malgré tout. Les efforts déployés pour faire passer « Cop City » coûte que coûte, malgré l’opposition publique, s’inscrivent dans le droit fil des mesures antidémocratiques et des lois anti-manifestation de plus en plus draconiennes, adoptées dans tout le pays. Et ceci dans une spirale bipartisane menant à l’autoritarisme, que nous faisons le choix d’ignorer à nos risques et périls.
Il est de plus en plus clair que ce n’est pas toujours autour des membres d’extrême droite du parti républicain que gravite la lutte contre l’autoritarisme. Dans certains centres urbains comme Atlanta – rappelez-vous aussi comment la police a récemment réagi aux manifestations à New York, Los Angeles, Chicago et Minneapolis – les démocrates sont en train d’ouvrir la voie à une société dont rêveraient les républicain·es d’extrême droite : où les décisions seraient prises par et pour les personnes qui détiennent déjà le pouvoir et où la police serait armée et prête à maintenir tout le monde à sa place.
Le référendum sur « Cop City »
C’est en juin 2021 que Joyce Sheperd, membre du conseil municipal d’Atlanta, présenta l’ordonnance 21-O-0637 proposant de louer à la Fondation de la police d’Atlanta 154 hectares de forêt publique, en vue de la construction de « Cop City ». La construction de l’infrastructure en tant que telle était prévue sur 34 hectares de terres coupées à blanc, dans la forêt de Weelaunee, à proximité d’un quartier d’Atlanta majoritairement noir. Des dizaines de cités policières de ce type ont été construites, ou sont en cours de construction, depuis l’insurrection causée par l’assassinat de George Floyd. La cité policière d’Atlanta en serait néanmoins le modèle phare : il s’agirait du plus grand complexe d’entraînement policier pour l’intervention armée en milieu urbain des États-Unis, ainsi que le plus visible.
La lutte en vue d’empêcher la construction a rassemblé des personnes de tous bords, notamment des militant·es antiracistes et des personnes opposées à la militarisation de la police. Des écologistes ont rejoint l’action afin de tirer la sonnette d’alarme quant aux effets potentiellement désastreux sur le climat de la destruction d’une si grande partie des espaces verts d’Atlanta. Des habitant·es considérant « Cop City » comme prenant part à l’embourgeoisement rampant de la ville étaient aussi au rendez-vous, ainsi que les personnes pensant simplement que l’argent du contribuable pourrait être mieux dépensé ailleurs, dans des services publics sous-financés par exemple. Sur place, les militant·es ont mobilisé la population pour manifester, organiser des actions directes sur les chantiers de construction, et mettre en place un réseau de campements forestiers, ainsi qu’une campagne de solidarité nationale.
En juin 2023, après deux ans de manifestations et de répression allant crescendo, le conseil municipal d’Atlanta s’est réuni pour un vote relatif au financement public de la construction de « Cop City ». De nouveau, les résident·es ont afflué vers l’hôtel de ville, au point que la session de commentaires du public a duré plus de treize heures, la grande majorité s’opposant fermement au projet. Une fois de plus pourtant, le conseil municipal a ignoré son électorat et a voté l’affectation de dizaines de millions de dollars d’impôts à la construction de « Cop City ».
Dès le lendemain, les habitant·es d’Atlanta ont alors adopté un type plus formel de commentaire public, pesant plus lourd juridiquement : une campagne référendaire en vue de faire abroger l’ordonnance de 2021, accordant à la Fondation de la police d’Atlanta un bail de location du terrain. Un tel type de référendum populaire (c’est-à-dire un vote portant sur une politique plutôt que sur une personnalité politique) serait une première à Atlanta.
Dans le cas d’une telle proposition de référendum, relative à une ordonnance soutenue par le maire et approuvée à deux reprises par le conseil municipal, on aurait pu s’attendre à ce que la municipalité réponde par une campagne de sensibilisation visant à persuader les habitant·es que « Cop City » est en fait une bonne chose. C’est bien de cette façon que la démocratie est censée fonctionner. À la place, les autorités municipales se sont évertuées à empêcher la tenue d’un vote populaire en y opposant tous les obstacles possibles.
La pétition citoyenne fut rejetée dans sa première version, sur un motif technique. Puis, lorsqu’elle fut adressée à nouveau et finalement acceptée, la ville d’Atlanta intenta une action en justice afin de limiter la collecte de signatures à certaines conditions, impliquant que les personnes chargées de la collecte devaient résider officiellement dans la ville. L’action en justice avait aussi pour but d’invalider la pétition dans son ensemble, au motif de son inconstitutionnalité dans l’État de Géorgie. Un juge de district a évité de statuer sur la deuxième objection, déclarant qu’elle ne serait examinée qu’une fois le référendum prévu au scrutin. Sur la question relative aux personnes autorisées ou non à collecter les signatures, il s’est prononcé en faveur de la circulation libre de la pétition et a prolongé de 60 jours le délai pour le dépôt des signatures.
Toutefois, après la présentation des 116 000 signatures dans le nouveau délai imparti, un nombre bien supérieur à l’ensemble des suffrages recueillis lors de la dernière élection du maire d’Atlanta, presque le double du nombre requis pour valider la tenue du référendum, la ville a fini par les rejeter. Et ce, au motif que la campagne n’avait pas respecté le délai initial, arguant du fait que le nouveau délai était erroné, le procès étant toujours en cours en raison d’un appel. Cet appel est actuellement examiné par la cour d’appel pour le onzième circuit des États-Unis [cour fédérale américaine située à Atlanta].
En outre, le conseil municipal a voté l’adoption de [procédures de vérification des signatures [type signature via des applications en ligne]](https://boltsmag.org/cop-city-referendum-signature-matching-atlanta/), critiquées par les spécialistes pour les problèmes qu’elles posent et le fait qu’elles aboutissent le plus souvent à l’exclusion des personnes marginalisées. Ces procédures ne s’appliqueraient de toute façon qu’une fois le jugement de la cour d’appel rendu et le processus validé. À l’heure actuelle, les 116 000 signatures sont donc dans des cartons, alors que l’organisation du référendum en est au point mort, et tandis que la construction de « Cop City » progresse.
L’antidémocratie en actes
Remplacer les maires et les membres des conseils municipaux – toutes et tous démocrates à l’origine – n’a rien changé. Après le vote de 2021 en faveur de la location d’un terrain pour « Cop City », de nombreux·ses membres de longue date du conseil municipal, dont Mme Sheperd, ont été évincé·es par une liste de jeunes démocrates se présentant avec des programmes progressistes. Malgré cela, le vote de 2023 pour financer « Cop City » fut presque identique à celui de 2021 (respectivement 11 voix contre 4 et 10 contre 4). De même, la maire qui soutenait initialement « Cop City », Keisha Lance Bottoms, a été remplacée par Andre Dickens, qui avait auparavant manifesté une certaine volonté de s’opposer aux projets de la police. Toutefois, depuis son entrée en fonction, M. Dickens s’est plutôt appliqué à superviser la suppression du référendum par voie bureaucratique et la répression policière brutale des manifestant·es.
Non seulement le changement de représentant·es démocrates n’a pas aidé, sur ce point, à faire aligner les autorités municipales sur leur électorat, mais au contraire, les tactiques utilisées par les démocrates d’Atlanta contre le référendum de « Cop City », reflètent directement les attaques contre les initiatives de vote direct menées par le parti républicain dans d’autres États.
Les initiatives publiques de consultations électorales et les référendums sont les seuls outils de démocratie directe à grande échelle dont nous disposons. Ils constituent donc un bon baromètre des institutions démocratiques. Il y a fort à parier que lorsqu’un parti au pouvoir au niveau local n’est pas à l’aise avec le fait que la population ait son mot à dire dans le processus législatif, ses membres ne gouvernent pas dans l’intérêt général. En effet, lorsqu’on permet aux électeurs et électrices de participer au processus législatif, ces dernier·es ont tendance à être d’accord sur un grand nombre de questions fondamentales.
À titre d’exemple, depuis 1996, toutes les initiatives des États visant à augmenter le salaire minimum ont été adoptées, avec une moyenne de 60 % de soutien dans les États rouges comme dans les États bleus. Durant la présidence de Barack Obama, le parti républicain a fait de l’opposition à l’extension de l’accès au Medicaid [programme d’assistance médicale pour les faibles revenus] un pilier de leur programme. Lorsque la mesure a néanmoins été soumise au vote, à la suite d’une demande populaire, elle a presque à chaque fois été approuvée. Un autre exemple, censé être la question polarisante par excellence : le droit à l’avortement. Les sept votes organisés depuis l’arrêt Dobbs de la Cour suprême, relatifs à la légalisation ou à l’interdiction de l’avortement, ont tous été favorables au principe de liberté en matière de droits reproductifs et sexuels. Quatre initiatives visant à protéger le droit à l’avortement ont été adoptées, tandis que trois autres visant à l’interdire ont échoué.
Les initiatives de consultation publique sont des mécanismes décisionnels très populaires et l’électorat des deux partis se montre extrêmement hostile aux instances législatrices qui tenteraient de leur retirer leur droit de vote direct. C’est pourquoi, même lorsque les États ou les collectivités locales aimeraient précisément empêcher la tenue de ces consultations publiques (généralement dans le cadre d’initiatives populaires auprès de l’électorat, mais contestées par les responsables de parti), ces instances s’évertuent toutefois à ne pas paraître opposées à la démocratie. À la place, elles ont tendance à adopter une approche plus subtile, de type mort lente, en légiférant de façon à rendre le processus plus coûteux et moins accessible, en opposant des obstacles bureaucratiques de mauvaise foi, ou en accumulant les longs recours en justice et les formalités techniques trop lourdes.
Certaines des méthodes les plus couramment utilisées par les États et les collectivités locales pour affaiblir les initiatives citoyennes consistent à essayer d’élever le nombre de voix favorables à partir duquel elles deviennent recevables. Par exemple, via l’augmentation du nombre de signatures requises ou l’élargisement de la zone géographique d’où les signatures doivent être obtenues (ce qui augmente les coûts des campagnes). Il est aussi commun de voir les délais et les exigences administratives modifiés arbitrairement, via l’imposition de règles dites de « sujet unique » par exemple. Qui, a priori relèvent du bon sens, mais qui, dans la pratique, permettent en fait aux tribunaux de rejeter certaines initiatives sous prétexte qu’elles porteraient sur plus d’un sujet à la fois. D’autres stratégies consistent à imposer un libellé de bulletin de vote qui divise ou qui induit en erreur, ou encore à soutenir des mesures concurrentes afin de créer la confusion pour l’électorat lors du vote.
En cas d’échec de telles tactiques, les instances législatives ont pu avoir recours à des projets de loi permettant d’inverser le résultat des votes directs en vidant les initiatives de consultation publique de leur substance. Les tribunaux ont aussi parfois eu raison d’initiatives citoyennes populaires en les déclarant inconstitutionnelles, sur la base de considérations techniques absurdes. Dans de rares cas, souvent relatifs au système carcéral, les agences gouvernementales ont simplement refusé d’obtempérer. Et c’est là que le rôle de la police prend tout son sens. Car, en fin de compte, qui est tenu de faire appliquer les règles et de qui répondent concrètement les personnes responsables de les faire respecter ?
Partout dans le pays, que ce soit au niveau des municipalités ou des États, les gouvernements ont recours à des manœuvres frauduleuses pour empêcher la tenue de votes directs, utiles pour faire adopter des politiques soutenues par la majorité de la population lorsque les partis au pouvoir s’y opposent. Et c’est exactement ce dont nous sommes témoins à Atlanta. Dans de nombreux cas, les campagnes de consultation citoyenne ont obtenu gain de cause en parvenant à surmonter les règles de découpage des circonscriptions. La question de savoir si cela sera encore possible à l’avenir dépendra du feu vert qui sera donné ou non à la police pour qu’elle réprime l’opposition, désormais sans avoir à se cacher.
L’État policier
Le rôle de la police est de faire respecter le statu quo. Or, pour faire respecter un statu quo profondément inégalitaire, il ne faut pas y aller de main morte. La police en tant qu’institution, est historiquement originaire d’Angleterre, où, à partir du XIIIe siècle, les gendarmes défendaient le pouvoir de la monarchie contre les masses. Une pratique similaire s’est développée au XVIIe siècle dans les colonies américaines et caribéennes, où des bandes d’hommes blancs armés étaient chargées de faire perdurer le système esclavagiste.
Les premiers services officiels de police aux États-Unis ont été créés par la classe dirigeante en riposte aux appels à la rébellion lancés par les abolitionnistes. La police moderne ne s’est donc pas développée afin de défendre les gens ordinaires envers les criminels, mais plutôt pour protéger les bénéficiaires d’un système d’exploitation racial contre les personnes qui souhaitaient changer ce système.
Aujourd’hui, certaines personnes pensent qu'il est tout à fait raisonnable de refuser de croire au rôle idéalisé que tiendrait la police dans l’avènement d’une société plus juste. Nous devrions au moins pouvoir nous accorder sur le fait que, dans la mesure où la police existe, elle devrait être tenue de rendre des comptes aux communautés qu’elle surveille, et non pas seulement aux personnes au pouvoir. On ne saurait trop insister sur le danger que représente une police militarisée, armée, arborant une attitude et des tactiques guerrières. Non seulement pour la sécurité de nos communautés, mais aussi contre toute opportunité de démocratisation des systèmes politique et économique des États-Unis.
Ce n’est pas par hasard si le projet « Cop City » a vu le jour en réaction au soulèvement de 2020 pour la justice raciale, qui fut lui-même une réponse du peuple à la violence raciste de la police. À cette époque en effet, la police a brutalisé les manifestant·es et attaqué les journalistes en toute impunité. Le ministère de la Sécurité intérieure a même reconnu avoir utilisé des camionnettes banalisées pour kidnapper des militant·es sous la menace d’armes. À la suite de ces événements, la création de « Cop City » a été proposée afin de former la police vers plus d’efficacité, comme s’il s’agissait d’une force d’occupation sur le terrain hostile d’une ville majoritairement noire.
Le fait que le « mini Gaza » de l’armée israélienne soit l’une des principales sources d’inspiration de « Cop City » en dit long. Bonne chance pour trouver ne serait-ce qu’une seule personne, quelle que soit sa position sur Israël et la Palestine par ailleurs, qui aimerait que la police intervienne dans son quartier de la même manière que l’armée israélienne opère à Gaza. Les personnes en faveur d’une police militarisée savent bien, sans pour autant le dire ouvertement, que les confrontations n’auront pas lieu dans leurs quartiers et qu’elles n’en seront pas les cibles.
En janvier 2023, comme pour ne laisser aucun doute sur le type de maintien de l’ordre que « Cop City » comptait faire appliquer, la police d’Atlanta fit une descente dans le campement de protestation « Stop Cop City », tirant au moins quatorze balles sur l’activiste Manuel Paez Terán, dit « Tortuguita », le tuant sur le coup. La police affirma alors que Tortuguita tenait une arme et lui avait tiré dessus. Les enregistrements de l’intervention indiquent toutefois que des tirs réciproques ont probablement été échangés par accident au sein des forces de police, tandis que le procureur a refusé de rendre publiques les preuves médico-légales.
Plus tard cette même année, alors que la campagne pour le référendum prenait de l’ampleur, la police d’Atlanta a arrêté des dizaines de manifestant·es pour cause de terrorisme intérieur, racket et autres délits passibles d’une peine d’emprisonnement de vingt ans ou plus. Ils ont ensuite arrêté trois des personnes gérant l’Atlanta Solidarity Fund [le fonds de solidarité d’Atlanta], ayant contribué à la libération sous caution de militant·es de « Stop Cop City ».
La stratégie de ciblage d’activités de soutien, telles que le fonds de paiement des cautions pour sortir de prison, ainsi que le caractère scandaleux de certaines accusations – accusations de terrorisme pour avoir porté des chaussures boueuses, intimidation pour avoir distribué des tracts sur le meurtre de Tortuguita – montre clairement que l’heure n’est pas à la prononciation de condamnations justes et impartiales. Ce type d’actions menées par la police et les procureur·es, tout comme les lois promulguées récemment dans tout le pays, criminalisant la dissidence et ouvrant la voie à la violence justicière contre les manifestant·es, vise clairement à briser le mouvement.
Peu après la répression des militant·es et des sympathisant·es, le greffier de la ville d’Atlanta a mis en ligne la pétition pour le référendum, y compris toutes les informations personnelles des signataires, exposant ainsi toutes les personnes en faveur d’un vote public sur « Cop City ». Après qu’il fut exigé par les militant·es que les informations soient supprimées, le conseil municipal ordonna au greffier de la ville de se conformer à la loi. Ce dernier ne l’a toutefois toujours pas fait. La bureaucratie semble donc pouvoir fonctionner sous des formes tout à fait répressives, comme c’est le cas dans ces exemples d’obstructions répétées contre le référendum. Malgré tout cela, sur le terrain, les organisateurs et organisatrices ont refusé de se laisser intimider et persistent actuellement à lutter contre « Cop City ».
Le pouvoir du peuple contre le pouvoir de la police
La menace la plus directe d’une dérive autoritariste semble habituellement plutôt venir du parti républicain. Avec la parade médiatique concentrant toute l’attention sur les élections bipartisanes à deux candidat·es, il est facile d’ignorer la manière dont les démocrates des villes libérales sont en fait en train de placer leurs pions vers une transition autoritaire. La lutte contre « Cop City » est emblématique d’un combat plus large : celui mené en faveur d’une gouvernance basée sur la volonté populaire, contre une classe politique qui semble de plus en plus prête à faire remplacer les institutions démocratiques par un État policier.
Le parti républicain de droite ne pose pas un problème immédiat à Atlanta, où l’establishment politique démocrate est arrivé au pouvoir à la suite du mouvement pour les droits civiques. En revanche, sciemment ou non, l’establishment politique démocrate est en train de préparer le terrain à l’extrême droite, en réprimant les consultations publiques et les droits civiques afin de préparer la police à la guerre contre sa propre population.
Ce phénomène n’est en aucun cas limité à Atlanta, et les répercussions de la lutte contre « Cop City » ne resteront pas locales. Par le biais de mesures antidémocratiques, de la criminalisation des protestations et de la militarisation de la police, la classe dirigeante tente de restreindre les possibilités de changement venant d’en bas. Plus nous perdrons ce genre de batailles, plus nos possibilités seront réduites.
Benjamin S. Case est chercheur, écrivain et acteur associatif de longue date dans la Rust Belt [« ceinture de la rouille », région industrielle du Nord-Est des États-Unis], où il vit. Il est chercheur au Centre pour le travail et la démocratie, où il dirige le Groupe d’action sur les consultations publiques et le référendum, et est membre du Groupe d’études sur la résistance.
Foto: Jacobin